Opzoeken
1380 - 1395 van 2520 nieuws bekijken
-

Enabel accompagne les producteurs d’ananas du Bénin vers l’obtention d'une certification d'exportation internationale
Reece-hermine ADANWENON | 23/04/2021
Dans le but d’augmenter les parts de marché de l’ananas au Bénin et à l’international, le programme de Développement de l’Entreprenariat dans la Filière Ananas (DEFIA) mis en œuvre par Enabel en collaboration avec le Comité de Liaison Europe - Afrique - Caraïbes - Pacifique (COLEACP) accompagne la Fédération Nationale des Coopératives Villageoises des Producteurs d’Ananas du Bénin (FENACOPAB) pour la certification de 80 exploitations agricoles de la filière ananas au standard GLOBAL G.A.P. Cette certification, une fois obtenue, permettra aux producteurs d’ananas du Bénin d’exporter leurs fruits partout dans le monde entier. L’objectif principal de cette action est de rassurer les consommateurs sur les conditions de production de l’ananas dans les exploitations agricoles qui minimisent les impacts sur l’environnement, avec une diminution de l’utilisation des intrants chimiques tout en garantissant la santé et la sécurité des producteurs et de leurs ouvriers. Après, le renforcement de capacité technique des producteurs, et la mise en place d’un Système de contrôle interne de suivi et de gestion de la certification au sein de la FENACOPAB, DEFIA entre dans la phase d’appui aux producteurs en matériel et équipements. Dans ce cadre, le programme un acquis des équipements de protection Individuelle au profit des producteurs et de leurs ouvriers agricoles. Ce lot d’équipement composé de : 240 bottes, 240 combinaisons phytosanitaire réutilisable, 240 gants en cuire, 240 Lunettes de protection, 240 masques respiratoires de traitement phytosanitaire à cartouche a été remis le jeudi 22 avril 2021 aux producteurs des 80 exploitations agricoles.Ces équipements seront dans les prochains jours complétés par des équipements d’hygiène sanitaire.
-
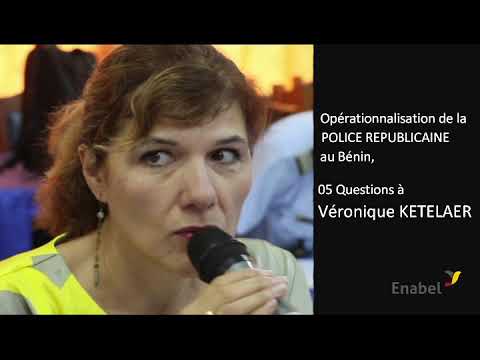
5 questions à Véronique Ketelaer, Responsable du Projet Police d'Enabel au Bénin
Reece-hermine ADANWENON | 22/04/2021
Qu’est-ce qu’une Police communautaire et commentaire faire pour que la Police Républicaine au Bénin le soit plus ?Dans cette vidéo, Véronique KETELAER, Responsable du Projet Police au Bénin qui participe à rendre la police béninoise opérationnelle et disponible pour toute la population béninoise répond à cette question.
-

L’arsenal juridique environnemental actualisé
Reece-hermine ADANWENON | 21/04/2021
Toiletter les textes et législations pour une meilleure préservation de l’environnement au Bénin. C’est l’un des objectifs du Projet d’appui au secteur (para) portuaire (PASPort) mis en œuvre par Enabel au Bénin depuis juin 2019. Après trois sessions, tenues entre mars et novembre 2020, un avant-projet de loi sur l’environnement a été présenté aux plus hautes autorités du Ministère du cadre de vie qui l’ont introduit dans le processus devant conduire à sa transmission à l’Assemblée Nationale en vue de son vote. Il faut noter que cet avant-projet de loi a bénéficié de l’assurance-qualité des experts du Service Public Fédéral (SPF) Santé et Environnement du Royaume de Belgique qui ont apporté leurs contributions. L’arsenal juridique environnemental en vigueur au Bénin date de plus de 20 ans et demeure une règlementation dont l’application reste limitée. Aussi, la Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC) du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) œuvre pour doter le Bénin non seulement d’une nouvelle loi sur l’environnement mais aussi, élaborer ses décrets d’application. Le projet PASPort s’associe à la DGEC et les autres partenaires publics et de la société civile (ONG, associations, personnes-ressources, entreprise, etc.) pour atteindre cet objectif. Ainsi, plusieurs sessions de travail ont eu lieu entre mars et novembre 2020 réunissant des personnes ressources mandatées pour élaborer ce nouveau projet de loi. Pour faciliter la mise en œuvre de cette loi une fois votée, deux autres sessions ont eu lieu entre janvier et mars 2021 pour réviser le décret portant règlementation du bruit et celui portant normes de qualité de l’air et le décret portant des déchets solides et normes de qualité des eaux résiduaires. L’original de ce processus tient non seulement en la complétude du travail- c’est en effet la première fois au Bénin qu’une loi est élaborée en même temps que ses textes d’application, mais aussi dans la démarche très participative et centrée sur le travail d’un « groupe d’experts » en opposition à une approche qui serait centrée sur « l’expert consultant ». L’une des raisons du succès de ce processus tient aussi à la méthodologie utilisée qui peut se résumer en trois points à savoir: - l’identification des experts par atelier et par domaine, - l’évaluation des forces et faiblesses des textes à réviser, - la préparation des ateliers fondée sur la stratégie du benchmarking. Les nouveaux textes sur l’environnement se sont donc enrichis non seulement des succès et échecs des textes actuellement en vigueur, mais aussi des textes des pays de la sous-région et d’ailleurs. Selon le professeur Martin Pépin AÏNA, Directeur Général de l’Environnement et du Climat, Enabel permet au Bénin d’élaborer des textes appropriés qui tiennent compte des réalités du pays et qui sont en cohérence avec les objectifs du gouvernement. Par ailleurs, Enabel et la DGEC comptent s’attaquer aux domaines restés jusque-là non règlementés. Ainsi, la prochaine étape sera de doter le Bénin d’un décret d’application sur la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en avril 2021 et d’un autre sur la lutte contre la pollution des sols avant la fin du mois de juin.
-

Rwanda: Towards increased family planning uptake and reduced number of home deliveries
Denise NSANGA | 17/04/2021
Decreasing family planning and home deliveries are among other key issues discussed in the Gakenke District Health Management Team meeting convened on 15-16 April 2021 in Musanze.Enabel is providing technical and financial support to address health challenges through its health projects. At the same time, a training on Primary Health Care standards for Nyarugenge District Health Center staff in charge of Quality Management is going on. Enabel is working with partner districts to equip health providers with knowledge and skills for quality improvement and accreditation of healthcare services. Belgium partners with Rwanda to increase the delivery of sexual and reproductive health services including Family Planing services as well as access of households to health care. The intervention is jointly implemented by Enabel and Rwanda’s Ministry of Health.
-
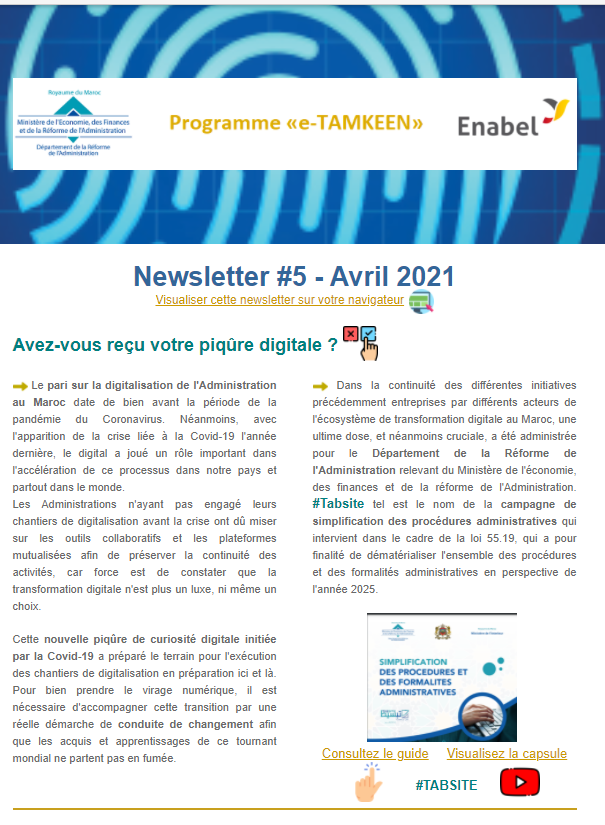
Consultez la 5éme newsletter trimestrielle de l’intervention e-TAMKEEN du Maroc!
Bassam ALAOUI MDAGHRI | 15/04/2021
Cette cinquième édition de la newsletter #eTAMKEEN s'intéresse particulièrement à l'initiative #Tabsite, le nom donné à la campagne de simplification des procédures administratives dans le cadre de la loi 55.19, qui a pour finalité de dématérialiser l'ensemble des procédures et des formalités administratives en perspective de l'année 2025.Elle informe également sur le baromètre des directions des systèmes d'information (DSI) en 2021 et les grands chantiers de digitalisation en cours de mise en œuvre dans les différentes Administrations marocaines, ainsi que sur les activités en cours du programme e-TAMKEEN, dont la poursuite de l'accompagnement de l'initiative #IDARATHON.Consultez la Newsletter via ce lien : https://bit.ly/3di0ApL Et pour vous inscrire à nos prochaines Newsletters, c'est par ici: http://eepurl.com/gYow-5Bonne lecture!
-

Au Bénin, l’apiculture se veut être une filière porteuse
Reece-hermine ADANWENON | 13/04/2021
Kondé BATEMA, âgé d’une soixante d’années est l’un des bénéficiaires des ruches installes dans le cadre de la mise en œuvre des Micro-Projets (MIC) du volet opérationnel du Programme d’appui au Développement des Filières Agricoles au Bénin (PROFI) exécuté par Enabel au Bénin. Propriétaire de 5 ha de plantations d’anacardiers, il a bénéficié de la mise en place de 14 ruches en 2018. Après trois ans, il se réjouit de l’augmentation de sa production mais aussi de ses revenus. «Cela contribue à la satisfaction de mes besoins grâce à la vente du miel. Je ne nourris pas mes abeilles,c’est plutôt elles qui me nourissent. L’an dernier, j’ai obtenu 350 000 FCFA de la vente de 175 litres de miel avec une augmentation de plus de 60% de ma production« . Ce sont là les propos tenus par Kondé Batema lors de la mission d’évaluation de la colonisation des ruches installées en 2018. Comme lui, Awali Mama Baparape, Issa Orou Yorou, Idrissou Boukari et Arouna Baboni, 4 producteurs de la coopérative villageoise des producteurs d’anacarde de Kabaré, village situé dans l’arrondissement de Fõtancé commune de Kouandé sont également bénéficiaires de 56 ruches. Trois ans après l’installation des ruches, les retombées commencent par être visibles au niveau de ces bénéficiaires. Les 56 ruches reçues par les 4 bénéficiaires du village de Kabaré ont permis à 13 autres producteurs don’t 3 femmes de bénéficier aussi de ruches, grâce à un mécanisme de solidarité mis en place par la coopérative de producteurs d’anacardier. Le mécanisme de solidarité consiste à faire une vente groupée du miel récolté et de répartir les recettes de la vente du miel entre les propriétaires des ruches et les autres membres de la coopérative (50% des ressources mobilisées reviennent aux producteurs bénéficiaires tandis que les 50% restantes sont utilisées pour la confection de nouvelles ruches au profit des autres membres de la coopérative n’ayant pas bénéficié de ruches). Ce mécanisme d’autofinancement des ruches est partagé par l’ensemble des membres de la coopérative villageoise des producteurs d’anacarde de Kabaré.
-

Enabel appuie l’amélioration du cadre réglementaire et institutionnel du secteur portuaire au Bénin
Reece-hermine ADANWENON | 13/04/2021
40 à 60 % des marchandises traitées au Port de Cotonou vont en direction des pays de l’arrière-pays(Niger, Burkina Faso, Mali, Tchad)et du géant voisin du Nigéria à travers les axes routiers. Le décret n°79-109 du 15 mai 1979 vieux de plus d’une quarantaine d’années et ses arrêtés d’application indispensables pour le sous-secteur du transport routier est caduque et nécessite une actualisation. Des efforts de modernisation ont été engagés par les pouvoirs publics à travers les différentes réformes en cours, néanmoins beaucoup restait à faire. Aussi, une séance de validation du rapport diagnostic du sous-secteur du transport routier au Bénin s’est tenue le 08 avril 2021 dans la salle de conférence du Conseil National des Chargeurs du Bénin pour l’actualisation dudit décret. Ce diagnostic a ébauché les pistes d’élaboration du nouveau décret et de ses arrêtés d’application. La séance, présidée par le Secrétaire Général Adjoint du Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) et du Directeur des Transports Terrestres, un connu la participation assidue des acteurs importants du sous-secteur. Maintes observations ont été portées et seront transmises aux consultants commis à l’actualisation des textes. L’étape suivante consistera à la proposition par les consultants, du projet du nouveau décret et de ses arrêtés d’application à faire valider par les parties prenantes et faire adopter en conseil des Ministres. Organisé par le Projet d’Appui au développement du Secteur Portuaire (PASPort), cette action permettra d’aider le Bénin dans la mise en place d’un cadre réglementaire actualisé locataire compte des évolutions pour une activité portuaire performante.
-

Bénin: Elaboration des plans de renforcement de capacités (PRC) des acteurs territoriaux du secteur agricole
Reece-hermine ADANWENON | 13/04/2021
Afin d’identifier les besoins en renforcement des compétences de chaque acteur clé du secteur agricole au niveau territorial (Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA), Directions Départementales de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche (DDAEP), Organisation Interprofessionnelle Paysanne (OIP), Chambre Nationale de l'Agriculture (CNA), et les mairies à travers leurs associations), le projet ARISA-B, une commande une étude en vue d’élaborer les plans de renforcement de compétences (PRC) en lien avec les capacitaires identifiés. La méthodologie utilisée prend en compte quatre étapes clé : l’élaboration des référentiels, l’analyse situationnelle, la détermination des lacunes capacitaires et l’adoption du plan de renforcement de capacités. Pour chacune de ces étapes, on peut retenir : - l’élaboration des référentiels de compétences : 60 participants ayant pris part à l’atelier « zéro » en provenance de : 7 ATDA, 7 DDAEP/12, 2 interprofessions, 2 faîtières d’Organisation Interprofessionnelle et Organisation Professionnelle Agricole nationale (OPA), la Chambre Nationale d’Agriculture (CNA) et l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), l’Union des Communes du Zou (UCoZ) ; - l’analyse situationnelle des compétences des acteurs : plus de 25 regroupements/mini-ateliers avec les acteurs ; 950 fiches individuelles renseignées ; 133 fiches de diagnostic organo-fonctionnel renseignées ;- la détermination des gaps capacitaires : Six (6) « mini-ateliers » avec un total de 90 participants en provenance de toutes les structures. On note une représentation plus importante des acteurs non étatiques (OIP/OPA/Chambres) ; - l’adoption du plan de renforcement : un atelier national présidé par le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) un permis de valider les Plans de renforcement de chaque acteur territorial. Chacune de ces étapes a mis les acteurs privés, décentralisés et déconcentrés au cœur du processus afin de leur permettre d’acquérir des aptitudes en matière d’élaboration des plans de renforcement de compétences, en même temps qu’elle a mis un point d’honneur sur la promotion du dialogue autour des centres d’intérêts des uns et des autres pour la promotion de l’agriculture. Au terme du processus, huit (08) Plans de Renforcement de Capacités ont été validés par les acteurs territoriaux du secteur agricole ne sept (07) PRC spécifiques pour les sept (07) Pôles de Développement Agricole et Un (01) PRC spécifique pour les acteurs non étatiques. Il ne s’agit pas d’avoir des PRC étiquettes « ARISA-B » ciblant uniquement un programme d’action à mettre en œuvre par le projet mais des PRC identifiant un ensemble d’actions pouvant être appuyées par différents acteurs et/ou PTF. ARISA-B : recrutement des organismes de formation pour la mise en œuvre des actions de renforcement de capacités. Pour l’ensemble des PRC, neuf (09) Cahiers Spécifiques de Charges (CSC) suivants ont été élaborés pour prendre en compte les domaines, axes et actions de renforcement de capacités. 1. Renforcement des mécanismes de programmation, coordination, de suivi-évaluation et de capitalisation des interventions au profit des acteurs territoriaux, conformément à leurs rôles et mandats ; 2. Approches et méthodes d’identification et de priorisation des investissements agricoles structurants ; 3. Exercice de la maîtrise d’ouvrage communale et les méthodes et techniques en matière de suivi de la réalisation et de la gestion durable des Investissements Agricoles Structurants ; 4. Assistance opérationnelle à la fourniture de services-clés relatifs au conseil agricole, au financement et à l’émergence des clusters au profit des acteurs des pôles de développement agricole ; 5. Accompagnement des acteurs non étatiques et privés des filières agricoles pour le développement institutionnel des organisations professionnelles et interprofessionnelles agricoles ; 6. Parcours d’acquisition des compétences pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des plans de renforcement des capacités des acteurs des pôles de développement agricole ; 7. Méthodes et techniques de concertation et de dialogue entre différentes familles d’acteurs des filières et entre elles et les acteurs publics ; 8. Gestion des services publics et gestion du changement ; et, 9. Renforcement des Capacités des acteurs du dialogue politique multi acteurs dans le secteur agricole au niveau des territoires. Sur la base de ces Cahiers de Charges, ARISA-B a conduit le processus de recrutement de sept (07) organismes de formation. Afin d’assurer la qualité tant de la démarche d’élaboration des outils que des choix pédagogiques, ces organismes sont appuyés transversalement par un cabinet spécialisé en ingénierie de formation.Pour la mise en œuvre des actions de formation, pour chacune d’entre elles, il a été élaboré un descriptif du module (objectif de formation, objectifs pédagogiques, contenu, démarche méthodologique, évaluation), un guide du formateur, un manuel de l’apprenant ainsi que les outils d’évaluation (pré et post tests, évaluations de satisfaction). A l’issue du processus, environ cent-cinquante (150) outils (descriptifs, guides et manuels) ont été élaborés et validés ; marquant ainsi la fin de la phase de préparation des PAC. Sur la base de ces outils, ARISA-B a lancé la phase B des PAC : celle du renforcement des capacités proprement dit des acteurs territoriaux du secteur agricole. Il faut souligner que l’appréciation de chaque module a été conduite sous la supervision des porteurs de fonctions au niveau national afin de s’assurer de l’arrimage du contenu des supports et de la démarche avec les dispositifs et stratégies sectoriels. Témoignage de Camille AZOMAHOU, participant à l’atelier de validation des PRC:« J'ai senti à l'issue des trois jours passés, le début d'un processus nouveau avec une démarche nouvelle en matière de renforcement des capacités et du point de vue de l'élaboration d'un plan de renforcement de capacités. Cela donne déjà à mon niveau un déclic pour entreprendre au niveau de l'Interprofession de l'Aviculture du Bénin (IAB) une restitution tout au-moins au Conseil d'Administration afin d'anticiper sur la suite à envisager. »
-

Au Bénin, le projet ARISA-B renforce les capacités des acteurs du secteur agricole
Reece-hermine ADANWENON | 13/04/2021
Le projet d’Appui au Renforcement des Institutions dans le Secteur Agricole au Bénin (ARISA-B), financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Enabel sur toute l’étendue du territoire du Bénin, a démarré ses activités opérationnelles en 2019. Après l’évaluation des besoins en formation, l’élaboration et la validation desplans de renforcement de capacités des acteurs territoriaux du secteur agricole, le projet a conduit le processus de préparation de ses actions de renforcement de capacité, clôturant ainsi, en juillet 2020, la première phase de l’approche Parcours d’Acquisition de Compétences retenue par le Projet pour une meilleure appropriation des réformes dans le secteur agricole.Les réformes engagées par le Gouvernement du Bénin dans le secteur agricole en 2016 ont induit de nouveaux mandats aux acteurs territoriaux dudit secteur. Afin d’accompagner lesdites réformes et les politiques sectorielles associées, l’Union Européenne met en œuvre, le Programme d’Appui au Développement Durable du Secteur Agricole (PADDSA) qui prend en compte un appui complémentaire décliné en deux dispositifs : un Appui Complémentaire Centralisé (ACC) et un Appui Complémentaire Territorialisé (ACT). Ce dernier est piloté sur la base d’une convention de délégation avec Enabel Bénin au travers du projet ARISA-B. Il vise à renforcer les acteurs au niveau des Agences Territoriales Départementales Agricoles (ATDA), Directions Départementales de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (DDAEP), Communes et leurs associations, Organisations Paysannes Agricoles (OPA), Organisation Interprofessionnelle (OIP) dans leurs compétences à assumer leurs rôles et mandats pour le développement agricole conformément au nouvel environnement généré par les réformes. Il doit également permettre de renforcer un dialogue positif et constructif entre acteurs pour la mise en œuvre des politiques agricoles. Une approche qui met les aptitudes des apprenants et des structures au centre du processus de renforcement de compétences… ARISA-B, dans le cadre du renforcement des institutions dans le secteur agricole au niveau des territoires, a opté pour l’approche « Parcours d’Acquisition de Compétences » (PAC). Le PAC est un ensemble approprié, structuré et accompagné de différents modes d’apprentissage qui permet à l’individu d’acquérir (et de s’approprier) les aptitudes nécessaires pour assumer certains rôles clés pour l’organisation qui l’emploie. Le PAC se déroule en trois grandes phases : une phase préparatoire (phase A), une phase de renforcement des capacités (phase B) et une phase de consolidation (phase C) visant à accompagner et suivre la mise en pratique en situation réelle de travail des acquis de formation. L’approche PAC marque une rupture avec les autres logiques de conception et de mise en œuvre d’actions de formation. Le PAC permet véritablement la construction de compétences, en ce sens qu’elle ne se contente pas seulement de laisser l’apprenant avec les capacités acquises à la fin de la phase de transmission de savoir, savoir-faire et savoir-être. Le PAC s’intéresse particulièrement au transfert des acquis de formation en situation de travail. Il est évident que l’on sort d’une formation avec des capacités et tant que ces capacités n’ont pas été prouvées en situation réelle de travail, on ne saurait parler de compétences. Ainsi, à la différence des autres approches, le PAC permet la construction de compétences car il accompagne l’apprenant jusque dans sa situation professionnelle et s’assure que les acquis de formation sont effectivement transférés.
-
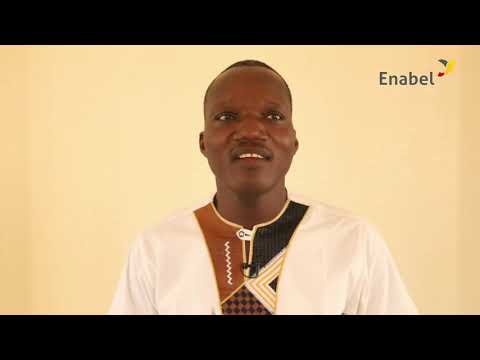
Bénin: Dans le cadre de la journée internationale des femmes, organisation de formations sur les causes et conséquences du cancer du sein
Reece-hermine ADANWENON | 08/04/2021
Le programme PASRIS mise en œuvre par Enabel au Bénin saisit l’occasion de la journée internationale des femmes pour organiser des activités dédiées à 45 femmes des communes de Klouékanmè, Toviklin et Lalo allant dans le sens de l’autonomisation féminine, de la lutte contre le cancer du sein et du renforcement de la confiance en soi. Découvrez dans cette vidéo les femmes de Klouékanmè, Toviklin et Lalo dans leur apprentissage.
-

Bénin: Sensibilisation des populations de Toffo sur les droits et l’accès à la santé sexuelle et reproductive
Reece-hermine ADANWENON | 08/04/2021
Dans la commune de Toffo, le 8 mars 2021 a été l’occasion pour le projet PASRIS mis en œuvre par Enabel et le Projet PASSRELLE de sensibiliser les populations sur l’importance du leadership et l’égalité des sexes pour une meilleure connaissance des droits et reproductifs. Une conférence publique a réuni à la maison des jeunes de Toffo, des leaders d’opinion, des têtes couronnées, des chefs traditionnels et religieux, des groupements des femmes et des hommes, des représentants des adolescents et des jeunes et de Mme le Maire de la Commune de Toffo.Visionnez la vidéo pour en apprendre d'avantage.
-

Au Bénin, Enabel vise à susciter l'intérêt des femmes pour les métiers portuaires et maritimes!
Reece-hermine ADANWENON | 08/04/2021
A Enabel au Bénin, l’autonomisation de la femme est au cœur de nos interventions et nous travaillons continuellement à identifier les discriminations Genre, à développer des actions innovantes qui répondent spécifiquement aux besoins des filles et des femmes. Découvrez dans cette vidéo l’appui d’Enabel à l’Amicale des Femmes du Port Autonome de Cotonou (AFPAC) pour sensibiliser les collégiennes et collégiens de Cotonou afin de susciter leur intérêt aux métiers portuaires et maritimes.
-

Enabel Bénin s'engage pour la révolution numérique et digitale par les femmes
Reece-hermine ADANWENON | 08/04/2021
Elles ont décidé de briser les stéréotypes en embrassant une profession généralement associée à la gente masculine : l'expertise informatique. Sélectionnées dans le cadre du concours Health Tech Challenge, elles ont, avec les autres membres de leurs équipes, proposé des solutions numériques pour la résolution des problèmes de santé. Pour Neïla ABDOU IMOROU et Laurencia BEHANZIN, il n’y a aucune barrière entre les hommes et les femmes et tous et toutes peuvent exercer le métier de leur choix. Découvrez en plus dans cette vidéo.
-

Au Bénin, l’AFD et Enabel soutiennent le plan national de riposte à la pandémie de Covid-19
Reece-hermine ADANWENON | 08/04/2021
Dans le cadre de l’initiative « COVID 19 - Santé en commun » lancée en avril 2020, l’Agence Française de Développement (AFD) a décidé d’octroyer un financement de 2 milliards de FCFA pour soutenir le Bénin dans sa lutte contre la pandémie. Mis en œuvre par Enabel, ce financement apporte un soutien immédiat au plan de riposte du gouvernement béninois. Grâce à l’appui du Projet « EQUITE », l’accompagnement de la France à la riposte nationale à la Covid 19 au Bénin a été concrétisé. Peuplé d’environ un million d’habitants avec 51% de femmes, le département des Collines au Bénin compte près de 172 000 ménages dont un quart sont dirigés par des femmes. Dans ce département, les Violences Basées sur le Genre prévalent dans toutes les localités. La prise en charge des personnes affectées demeure limitée et d’une manière générale, note une absence de réponse structurée : seuls les Centres de Promotion Sociale fournissent une assistance psychosociale, avec l’appui des ONG locales. Selon les résultats des enquêtes nationales STEPS 2015, la prévalence dans ce département de l’Hyper-Tension Artérielle et du diabète serait respectivement de 29,7% et de 16%. Malheureusement, plus de 3/4 des individus dans le département des collines n’ont jamais contrôlé leur tension artérielle et 95% sont des personnes vivantes avec le diabète qui s’ignorent. A ce tableau social et sanitaire préoccupant, s’est ajouté l’épidémie de pandémie de Covid-19 qui n’a épargné aucun département du pays. Depuis mars 2020, le Bénin a enregistré 6501 cas et 81 décès. Ce soutien se concrétise à travers plusieurs appuis tels que : le renforcement du plateau technique avec la remise au Ministère de la Santé de près de 60.000 kits de PCR, d’équipements de soins d’urgence et de réanimation, du matériel de surveillance des cas hospitalisés, la formation des personnels de laboratoire, la remise d’un lot de 3000 m3 d’oxygène permis de remplir plus de 400 bonbonnes de 7 m3 à destination des centres de traitement pour la prise en charge des cas les plus tombes de COVID-19 sans oublier la réhabilitation du centre de santé de Tchatchégou pour la prise en charge des épidémies dans le département des Collines. 28.000 ménages du département des collines ont été directement touchés par la mobilisation communautaire initiée dans le cadre de la prévention de la COVID-19 avec prise en compte du genre. De plus, les équipements acquis et remis au Ministère de la Santé ont été répartis dans les différents centres de prise en charge du Covid-19 du pays. Au-delà de leur utilisation dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID, ils bénéficieront au système de santé et ainsi à l’ensemble des populations.
-

Bénin: Un lot de matériel médical remis à la DDS-Collines pour améliorer les Soins Obstétricaux Néonataux d'Urgence
Reece-hermine ADANWENON | 08/04/2021
Dans le cadre du financement de 13.5 milliards de FCFA accordé par l’Agence française de développement (AFD) pour la mise en œuvre du projet « Ensemble pour une Qualité des Soins Inclusives et Transparente, orientée vers l’Égalité Genre » EQUITE, un important lot de matériel médical a été remis aux autorités du département des collines, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le Jeudi 25 Mars 2021 à Dassa. A travers cet appui, l’Agence Française de Développement contribue au renforcement du plateau technique du département des collines pour la réduction du taux de mortalité et de morbidité néonatale.Un lot d’équipements composés de : 23 kits AMUI, de 19 ventouses obstétricales, de 20 ballons de ventilation pour nouveau-nés et adulte, 53 aspirateurs électriques et manuels de mucosités, 4 concentrateurs d’oxygène, 4 lampes chauffantes, un échographe et un analyseur d’ions, a été mis à la disposition des maternités du département des Collines. D’un coût global de 51 millions de FCFA, ces équipements contribueront à la réduction de la mortalité maternelle au Bénin qui stagne depuis plus de 10 ans autour de 391 décès maternels pour 100.000 naissances-vivantes. Mais aussi, celle néonatale estimée qui représente à l’heure actuelle un défi pour le système de soins béninois en général et du département des Collines en particulier. Cette dotation permet d’atteindre une partie essentielle du résultat 1 du projet à savoir « la promotion des services de santé promotionnels, préventifs et curatifs de qualité par rapport aux Maladies Non-Transmissibles (MNT) et les Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence (SONU), tenant compte des besoins spécifiques des femmes & des adolescent(e)s & enfants dans les Collines avec une meilleure redevabilité des patients ». En effet l’une des réalisation phare de cette composante est la mise à niveau du plateau technique des formations sanitaires des départements des Collines et du Borgou à travers leurs équipements en matériels médicaux de qualité. Cette action s’inscrit dans une démarche de qualité et de soins centrés sur le client qui est l’un des principes directeurs du projet.
